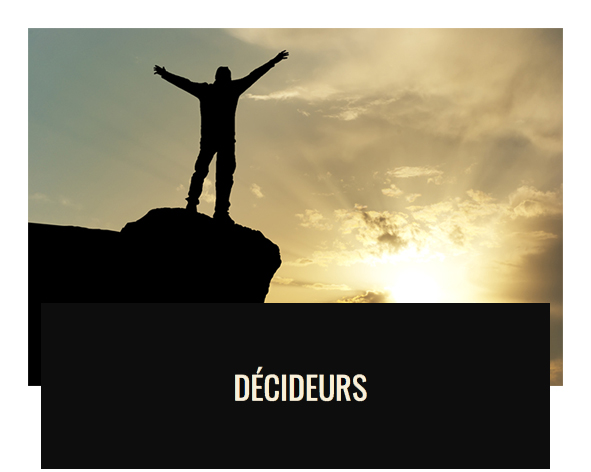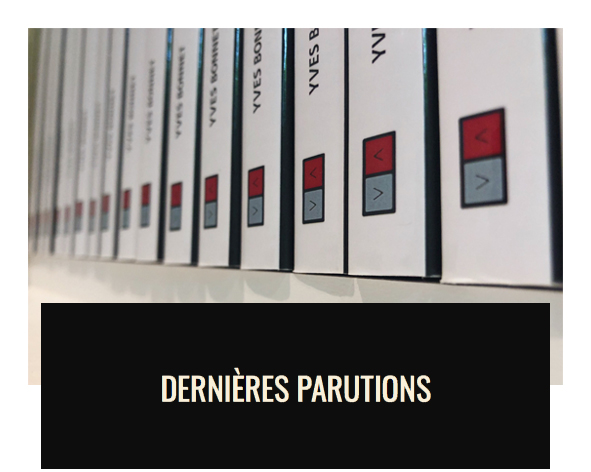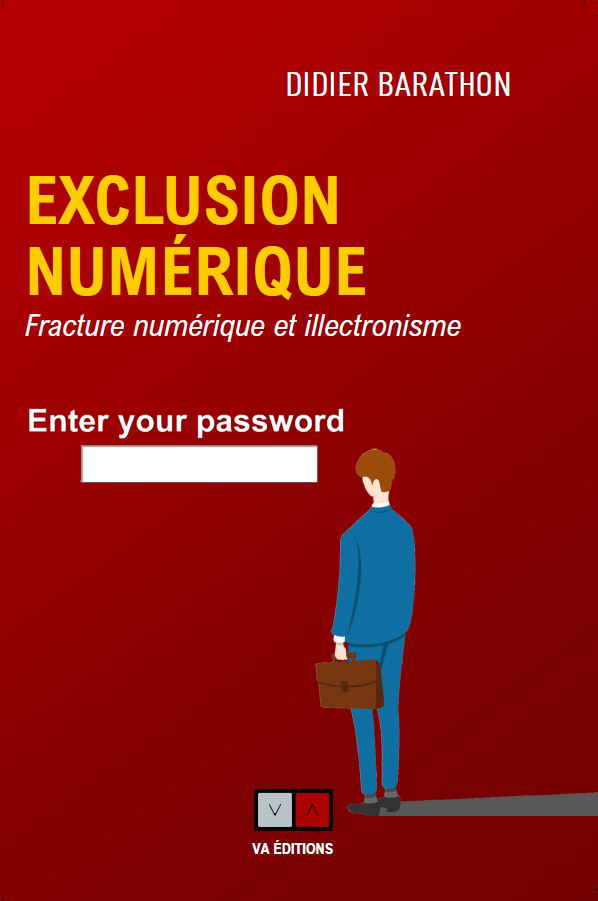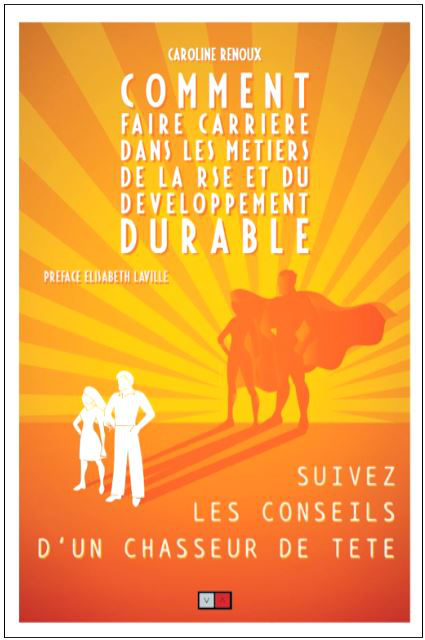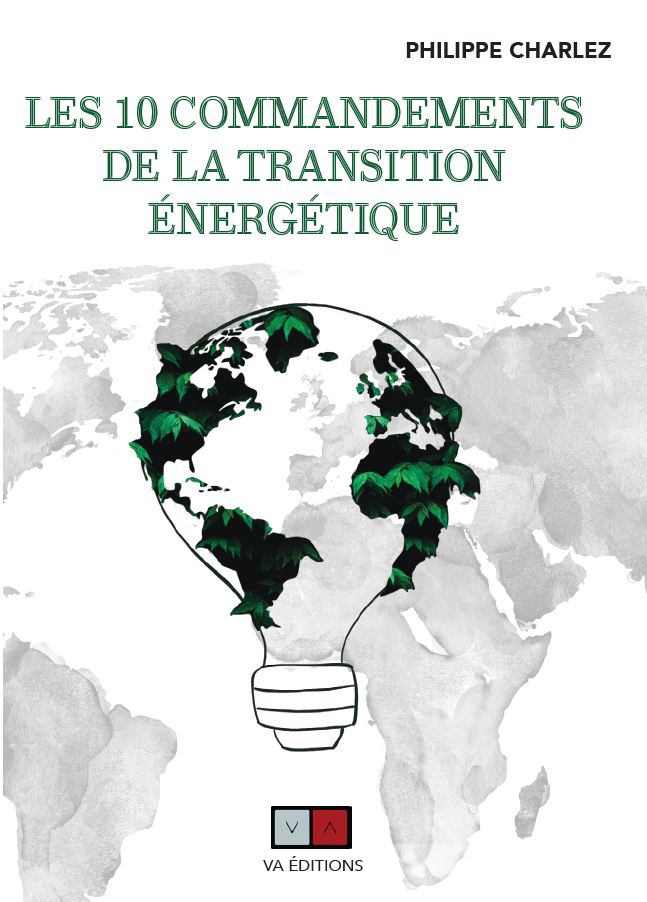Des salaires au moins égaux au SMIC, une question de conformité, mais aussi de compétitivité
L’équation devient de plus en plus difficile à résoudre pour les branches professionnelles. Alors que le SMIC a connu plusieurs revalorisations automatiques depuis 2023, certaines conventions collectives n’ont toujours pas adapté leurs grilles salariales. Le 27 octobre 2025, la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement proposé par le Parti socialiste destiné à corriger cette situation. Son principe est simple : l’accès aux allègements de cotisations sociales serait restreint pour les entreprises relevant de branches dont les minima sont en dessous du SMIC. Un signal adressé au patronat, mais aussi une manière pour le gouvernement de lier politique salariale et incitation économique.
Dans l’ensemble de l’économie, la question des minima salariaux dépasse le simple débat social. Selon les derniers chiffres du ministère du Travail, 11% des branches affichent encore un ou plusieurs niveaux de rémunération inférieurs au SMIC. Ces écarts concernent principalement les métiers à faible qualification et les secteurs de services à la personne, du nettoyage ou de l’hôtellerie-restauration, où les marges sont structurellement faibles.
Pour ces employeurs, chaque hausse du SMIC se traduit par un effet d’écrasement des grilles : la base conventionnelle devient illégale du jour au lendemain, mais sa révision exige des négociations parfois longues et complexes. À ce jour, cinq branches n’ont toujours pas procédé à la mise à jour complète de leurs grilles, en dépit des avertissements du ministère du Travail. La députée Christine Pirès Beaune, à l’origine de l’amendement, a dénoncé une « forme d’inertie » qui mine la crédibilité du système. Le texte prévoit ainsi de conditionner les exonérations de charges au respect du SMIC, introduisant un levier de contrainte financière inédit.
L’objectif est clair : pousser les branches à accélérer leur adaptation. Mais derrière cette volonté de justice salariale se cache aussi une problématique de compétitivité. Les fédérations patronales redoutent qu’une telle mesure pénalise les entreprises les plus fragiles : la perte d’exonérations pourrait représenter jusqu’à 3% de la masse salariale pour certaines structures. Dans les faits, le gouvernement espère avant tout instaurer une dynamique de mise en conformité sans alourdir excessivement le coût du travail.
Dans l’ensemble de l’économie, la question des minima salariaux dépasse le simple débat social. Selon les derniers chiffres du ministère du Travail, 11% des branches affichent encore un ou plusieurs niveaux de rémunération inférieurs au SMIC. Ces écarts concernent principalement les métiers à faible qualification et les secteurs de services à la personne, du nettoyage ou de l’hôtellerie-restauration, où les marges sont structurellement faibles.
Pour ces employeurs, chaque hausse du SMIC se traduit par un effet d’écrasement des grilles : la base conventionnelle devient illégale du jour au lendemain, mais sa révision exige des négociations parfois longues et complexes. À ce jour, cinq branches n’ont toujours pas procédé à la mise à jour complète de leurs grilles, en dépit des avertissements du ministère du Travail. La députée Christine Pirès Beaune, à l’origine de l’amendement, a dénoncé une « forme d’inertie » qui mine la crédibilité du système. Le texte prévoit ainsi de conditionner les exonérations de charges au respect du SMIC, introduisant un levier de contrainte financière inédit.
L’objectif est clair : pousser les branches à accélérer leur adaptation. Mais derrière cette volonté de justice salariale se cache aussi une problématique de compétitivité. Les fédérations patronales redoutent qu’une telle mesure pénalise les entreprises les plus fragiles : la perte d’exonérations pourrait représenter jusqu’à 3% de la masse salariale pour certaines structures. Dans les faits, le gouvernement espère avant tout instaurer une dynamique de mise en conformité sans alourdir excessivement le coût du travail.
Un nouvel équilibre entre incitation et sanction
L’amendement adopté s’inscrit dans une logique déjà amorcée par la loi du 16 août 2022, qui permet au ministère du Travail de fusionner ou restructurer les branches ne respectant pas leurs obligations de négociation. Mais cette fois, la contrainte se veut plus directe : toucher au levier fiscal, là où les dispositifs précédents misaient sur la menace institutionnelle. En d’autres termes, une entreprise dépendant d’une convention non conforme pourrait perdre une partie de ses avantages financiers, sans pour autant voir ses salaires directement modifiés.
Cette articulation entre sanction et incitation marque une évolution dans la stratégie publique. L’État s’affirme non seulement comme garant du SMIC, mais aussi comme acteur de régulation économique. Catherine Vautrin, ministre du Travail, a défendu cette approche lors de son audition devant la commission : « Nous devons veiller à la cohérence du système. Un salarié payé au-dessous du SMIC dans une branche non révisée, c’est une distorsion que ni le marché ni la loi ne peuvent accepter ».
Le sujet n’est pas purement social : il touche à la concurrence entre entreprises. Celles qui se conforment rapidement aux relèvements du SMIC supportent un coût supérieur à celles qui tardent à réviser leurs minima. D’où l’idée d’une mesure correctrice, pensée comme une réallocation des incitations publiques plutôt qu’une sanction punitive.
Cette articulation entre sanction et incitation marque une évolution dans la stratégie publique. L’État s’affirme non seulement comme garant du SMIC, mais aussi comme acteur de régulation économique. Catherine Vautrin, ministre du Travail, a défendu cette approche lors de son audition devant la commission : « Nous devons veiller à la cohérence du système. Un salarié payé au-dessous du SMIC dans une branche non révisée, c’est une distorsion que ni le marché ni la loi ne peuvent accepter ».
Le sujet n’est pas purement social : il touche à la concurrence entre entreprises. Celles qui se conforment rapidement aux relèvements du SMIC supportent un coût supérieur à celles qui tardent à réviser leurs minima. D’où l’idée d’une mesure correctrice, pensée comme une réallocation des incitations publiques plutôt qu’une sanction punitive.
Une transition sous contrainte pour les branches
Les effets de la mesure pourraient être significatifs pour certains secteurs. En 2022, près de 40% des branches comptaient encore au moins un niveau de rémunération inférieur au SMIC. Ce taux est tombé à 12 branches en 2024, puis à 11% en 2025, selon les données du ministère du Travail. Une amélioration réelle mais incomplète. À mesure que le SMIC progresse — environ 2% de hausse semestrielle depuis deux ans —, les conventions collectives doivent suivre le mouvement, sans quoi elles se retrouvent mécaniquement en dessous du plancher légal.
Pour les employeurs, cette dynamique crée une tension budgétaire. Les ajustements successifs du SMIC augmentent la masse salariale et fragilisent les structures à faible rentabilité. Les partenaires sociaux craignent un cercle vicieux : des hausses de coûts, suivies de pertes de compétitivité, puis d’un ralentissement des embauches. Dans ce contexte, le nouvel amendement cherche à concilier deux impératifs contradictoires : garantir la conformité salariale tout en évitant de freiner l’emploi.
Du point de vue macroéconomique, le dispositif pourrait aussi peser sur les équilibres budgétaires. Les allègements généraux de cotisations représentent plus de 70 milliards d’euros par an selon la Cour des comptes ; en réduire une partie pour certaines branches reviendrait à créer un signal sélectif fort, susceptible de redessiner les hiérarchies de coûts entre secteurs. Les observateurs y voient un test politique : celui de la capacité du gouvernement à conjuguer justice sociale et pragmatisme économique.
Pour les employeurs, cette dynamique crée une tension budgétaire. Les ajustements successifs du SMIC augmentent la masse salariale et fragilisent les structures à faible rentabilité. Les partenaires sociaux craignent un cercle vicieux : des hausses de coûts, suivies de pertes de compétitivité, puis d’un ralentissement des embauches. Dans ce contexte, le nouvel amendement cherche à concilier deux impératifs contradictoires : garantir la conformité salariale tout en évitant de freiner l’emploi.
Du point de vue macroéconomique, le dispositif pourrait aussi peser sur les équilibres budgétaires. Les allègements généraux de cotisations représentent plus de 70 milliards d’euros par an selon la Cour des comptes ; en réduire une partie pour certaines branches reviendrait à créer un signal sélectif fort, susceptible de redessiner les hiérarchies de coûts entre secteurs. Les observateurs y voient un test politique : celui de la capacité du gouvernement à conjuguer justice sociale et pragmatisme économique.