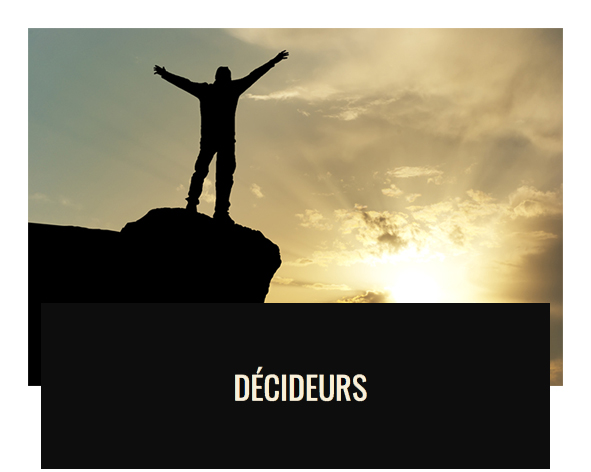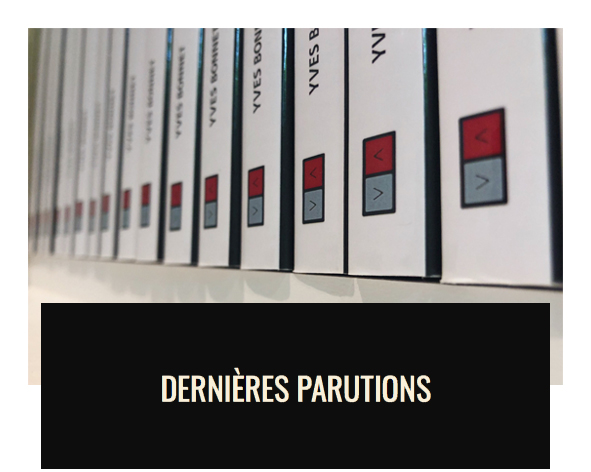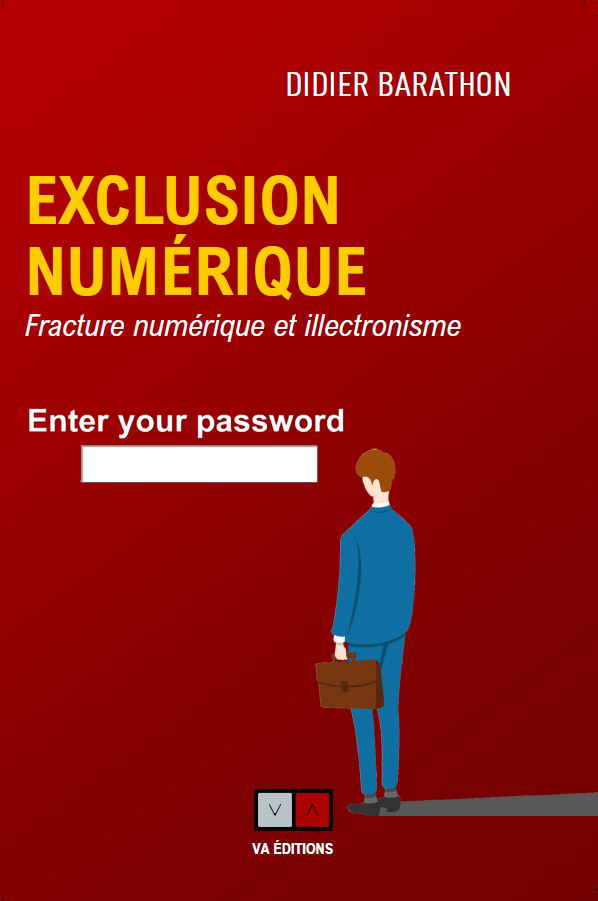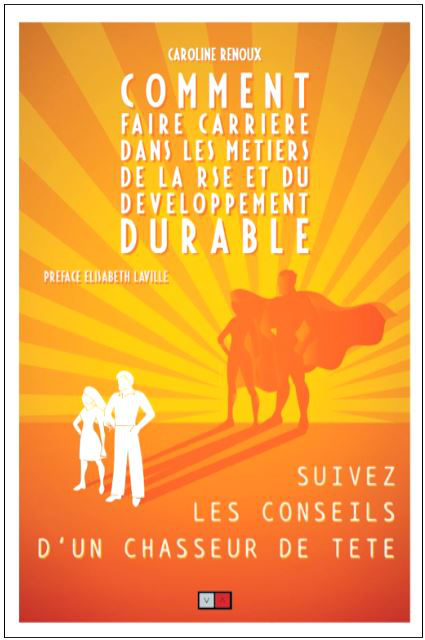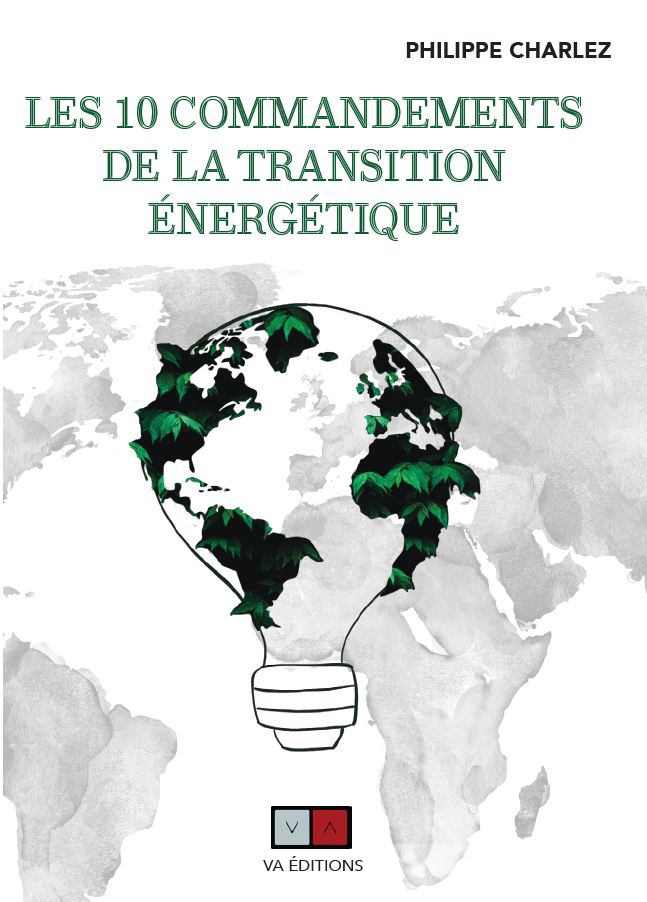Absentéisme : une dynamique qui pèse sur l’organisation des entreprises
Selon WTW, 35 % des salariés ont connu au moins un arrêt en 2024. La durée moyenne s’élève à 24,1 jours, contre 23,3 en 2023. Les arrêts longs (>90 jours) ne concernent que 6 % des cas, mais ils représentent 57 % du total des jours d’absence, contre 48 % en 2019. La gestion de l’absentéisme ne se limite plus aux absences courtes, mais repose sur la prévention et l’accompagnement des arrêts prolongés.
Le baromètre révèle des écarts significatifs selon les professions. Les ouvriers affichent un taux d’absentéisme de 7,37 %, les employés 6,79 %, contre seulement 2,37 % pour les cadres. Cependant, la durée moyenne des arrêts de ces derniers progresse, atteignant 20,2 jours. Les CDD (2,3 %) restent moins concernés que les CDI (5,3 %), ce qui interroge sur la fidélisation et les conditions de travail des effectifs stables.
Le baromètre révèle des écarts significatifs selon les professions. Les ouvriers affichent un taux d’absentéisme de 7,37 %, les employés 6,79 %, contre seulement 2,37 % pour les cadres. Cependant, la durée moyenne des arrêts de ces derniers progresse, atteignant 20,2 jours. Les CDD (2,3 %) restent moins concernés que les CDI (5,3 %), ce qui interroge sur la fidélisation et les conditions de travail des effectifs stables.
Les jeunes en arrêt plus souvent, les seniors plus longtemps
Les disparités générationnelles sont également marquées. Les 20–30 ans connaissent la fréquence d’arrêts la plus élevée (1,9 arrêt par an), tandis que les 60–70 ans ont des arrêts beaucoup plus longs (44,5 jours). Les femmes présentent un absentéisme supérieur (6,1 % contre 4,5 % pour les hommes). Enfin, certains secteurs apparaissent critiques : santé et action sociale (8,5 %), hébergement-restauration (8 %) et transport-entreposage (6,8 %) affichent des records d’absentéisme, possiblement liés aux conditions de travail qui se sont dégradées ces dernières années..
Les directions RH doivent de fait cibler leurs actions : renforcer la prévention dans les métiers à forte pénibilité, améliorer l’ergonomie et l’organisation du travail pour les seniors, et développer des dispositifs spécifiques pour les jeunes salariés confrontés à une fréquence d’arrêt élevée.
Les directions RH doivent de fait cibler leurs actions : renforcer la prévention dans les métiers à forte pénibilité, améliorer l’ergonomie et l’organisation du travail pour les seniors, et développer des dispositifs spécifiques pour les jeunes salariés confrontés à une fréquence d’arrêt élevée.
Les risques psychosociaux au premier plan : un enjeu de management
L’absentéisme n’est plus uniquement lié aux maladies ordinaires. En 2024, les risques psychosociaux expliquent 36 % des arrêts longs, contre 32 % un an plus tôt. Stress et burnout se hissent en tête des causes d’absence prolongée.
Pour Noémie Marciano, directrice de l’activité Assurance de personnes chez WTW : « La hausse de l’absentéisme en 2024 est bien plus qu’un indicateur social : c’est un signal d’alarme pour les entreprises ». Ce constat impose aux services RH et aux managers d’intégrer la santé psychologique au cœur de leurs politiques d’entreprise, mais aussi d’anticiper les risques inhérents à leur activité pour réduire le recours aux arrêts.
Pour Noémie Marciano, directrice de l’activité Assurance de personnes chez WTW : « La hausse de l’absentéisme en 2024 est bien plus qu’un indicateur social : c’est un signal d’alarme pour les entreprises ». Ce constat impose aux services RH et aux managers d’intégrer la santé psychologique au cœur de leurs politiques d’entreprise, mais aussi d’anticiper les risques inhérents à leur activité pour réduire le recours aux arrêts.