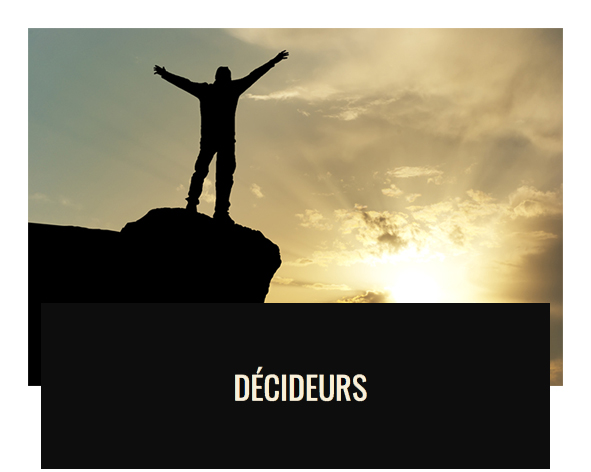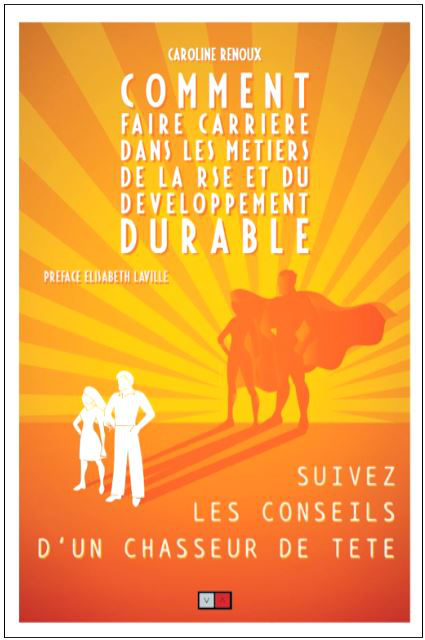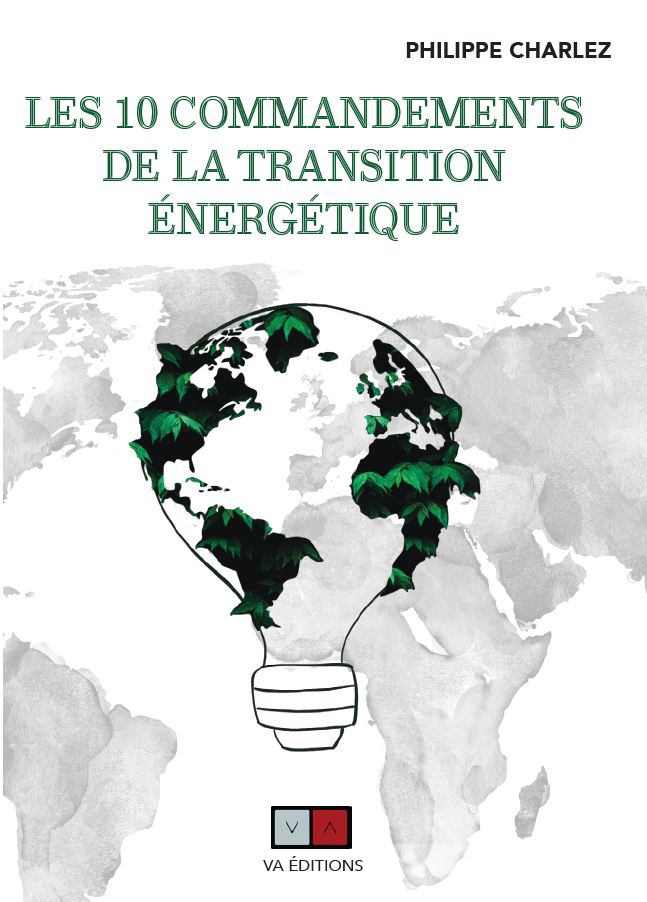Votre livre s'intitule Management, le grand retour du réel. De quelle réalité parlez-vous ?
De celle qui s’impose aux entreprises, aux salariés et à leurs managers. La réalité de la violence de la mondialisation, la fin des illusions sur ce que le « néo-management » devait apporter de positif aux salariés. La difficulté, de plus en plus grande, d’être un chef, dépositaire d’une autorité et en capacité de délivrer une vision qui ne soit pas cosmétique ou factice. Le développement considérable, enfin, des attentes que les salariés ont envers leurs entreprises, seules institutions qui restent solidement établies aujourd’hui.
Dans l'introduction de votre livre, vous citez Gramsci : « La crise est ce qui sépare l'ancien du neuf ». Quelle est nature de cette crise ? Et quelles en sont les conséquences pour l'entreprise ?
La crise dont je parle est bien sûr celle qui s’est déclenchée en 2008 sans que l’on en tire toutes les conclusions. En effet, l’entreprise, comme du reste la plupart des institutions, a voulu croire qu’il ne s’agissait que d’un accident de parcours, une tempête passagère, exigeant tout au plus des ajustements techniques en attendant que la croissance ne revienne et que tout reprenne comme avant… Il faut pourtant se détromper. En 2008, c’est tout un monde d’illusions qui s’est dissipé révélant les béances d’une crise non seulement financière mais économique, sociale, politique et morale. Face à ce vertige il serait vain de vouloir se raccrocher aux repères et aux certitudes d’hier. Un monde nouveau en train de naître sous nos yeux : celui de la mondialisation malheureuse. Il est porteur de défis, de compétitions et même d’affrontements qui ne pourront être relevés sans de nouvelles visions, de nouveaux projets et de nouvelles valeurs.
Selon vos mots, les managers constituent une « véritable élite née au feu de la guerre économique ». Pourquoi ce vocabulaire de combat ?
Ce vocabulaire de combat est en fait celui de la réalité que vivent les entreprises : elles élaborent des stratégies, conquièrent des marchés, accomplissent des raids boursiers, s’emparent de technologies clés, etc. Cette analogie lexicale avec la chose militaire souligne la véritable nature de la mondialisation, qui représente une sorte de “guerre totale” puisqu’elle exige que ses différents protagonistes y engagent leur société entière. Or, dans cet affrontement, les managers paient un lourd tribut car ils se trouvent sur la ligne de front, c’est-à-dire là où les discours lénifiants se brisent sur la réalité. Dans un monde encore dominé par les marchands d’illusions, ils sont d’indispensables messagers du réel. Ils savent, eux, que dans la mondialisation, il y a des perdants et des gagnants et qu’il vaut mieux faire partie des gagnants… Je pense donc qu’ils méritent d’être davantage entendus, aussi bien dans la société tout entière, que dans leurs entreprises car leur âpre lucidité est un gage de renouveau.
Vous appelez les managers à se libérer des illusions médiatiques, technologiques, idéologiques, managériales… Quelles sont les principales chimères à dégonfler ?
Le management prétendument moderne passe son temps à inventer des subterfuges, plus ou moins nouveaux d’ailleurs, pour compenser la difficulté de fond qui est celle du sens. Comme l’entreprise, à l’image de la société d’ailleurs, est en panne de vrai projet collectif - lequel est remplacé par des objectifs sans fin de performance dont les bénéficiaires sont flous et qui coûtent humainement très cher - on agite des nouveaux concepts. Le plus récent est celui du bonheur au travail, qui est un contresens absolu. Prenons cet exemple qui est emblématique du subterfuge : personne ne cherche le bonheur au travail. Certes, chacun souhaite, très légitimement, que le temps qu’il passe au travail soit un temps qui ait du sens, qui serve à quelque chose, qui lui permette de réaliser des choses, de poursuivre des projets et d’apprendre de nouvelles choses… Mais le bonheur, c’est autre chose : c’est le résultat d’une vie, dans laquelle la vie professionnelle n’est qu’un élément. Théoriser le bonheur au travail est donc doublement pervers. D’abord parce qu’il fait croire que les gadgets de type chief happinness officers ou autres vont remplacer ce qui manque vraiment au travail, à savoir le sens. Ensuite, de façon plus perverse encore, parce que cela aboutit à renforcer l’aliénation du salarié en lui faisant croire que c’est au travail qu’il trouvera le bonheur. Tant qu’à faire, pourquoi ne pas vivre 24h/24 dans l’entreprise, y trouver sa femme ou son mari et y élever ses enfants ! On sent poindre, à cette description, un glissement totalitaire, dans la mesure où l’entreprise devrait intégrer et assouvir l’ensemble des aspirations humaines.
Votre livre propose aux managers de « précieux conseils pour recréer les conditions de l'engagement dans l'entreprise ». Quels sont les contours de cet engagement que vous appelez de vos vœux ?
Ce que me dit mon métier et mon expérience, c’est que les hommes s’engagent, c’est-à-dire acceptent de consacrer une énergie supplémentaire à leur activité professionnelle, au détriment d’autres activités, à partir du moment où l’offre de projet qui leur est faite contient 4 ingrédients : du sens (pourquoi faisons-nous cela ? Et qu’est-ce que j’y gagne ?), de l’émotion (qu’y aura-t-il d’excitant dans cette affaire et qu’est-ce qui vaudra le coup de faire des efforts ?), un minimum de degré de liberté (en quoi suis-je réellement contributeur, voire propriétaire, d’une partie de la solution à bâtir ?), et une dimension communautaire (que font mes pairs ? quelle est la dimension réellement collective ?) On voit bien que le discours corporate classique ne répond pas à ces aspirations. Il est généralement faible en sens avec des objectifs globaux assez peu parlants pour le local et la pression du court terme, factice en émotion et en envie, phagocyté par les discours creux des « valeurs » et des communications managériales, quasi nul sur le degré de liberté du fait de l’invasion des process, des reportings et des processus de contrôle en tout genre, et enfin absent de toute dimension communautaire assumée… Dès lors c’est au manager de pallier cette lacune en imaginant des réponses pertinentes en puisant dans sa propre vision de son rôle. Or, le plus souvent, rien ne l’a hélas préparé à ce rôle qu’il accomplit aujourd’hui dans une solitude proprement héroïque.
Vous exhortez aussi les managers à « donner leur pleine mesure au service de la société tout entière » et vous semblez vouloir en faire des militants de l'entreprise. Quelle devrait être aujourd'hui, selon vous, la place de ces entreprises dans la société ?
Je me borne à constater que, dans un contexte de fort déclin du politique, l’entreprise tend à remplir des fonctions qui n’étaient pas initialement les siennes et que de la sorte, elle peut contribuer à revivifier l’ensemble de la société. Pour ne prendre qu’un exemple, il apparaît que le fameux “vivre ensemble” qui, depuis de nombreuses années fait office de pierre angulaire du discours politique n’est plus qu’un songe creux, l’évolution de la société française étant plutôt marquée par nombre la progression de l’individualisme, la montée des communautarismes, et la tentation du repli sur soi. Or, face à ce péril mortel, l’entreprise peut s’imposer comme un recours à condition de s’affirmer sans complexe comme une communauté d’action qui rassemble des hommes et des femmes de divers horizons, assure la transmission de savoir-faire mais aussi de savoir-être, entretient une mémoire commune et une vision partagée de l’avenir. En d’autres termes, elle peut être le creuset d’un “faire ensemble” bien plus tangible, réel et dynamique que le mièvre et fallacieux “vivre ensemble”. En ce sens, l’influence des managers déborde largement le cadre étroit de l’entreprise. Je suis persuadé qu’ils ont, en raison de leur réalisme, de leur abnégation et de leur dévouement un grand rôle à jouer au service de notre pays.
pour commander
pour commander